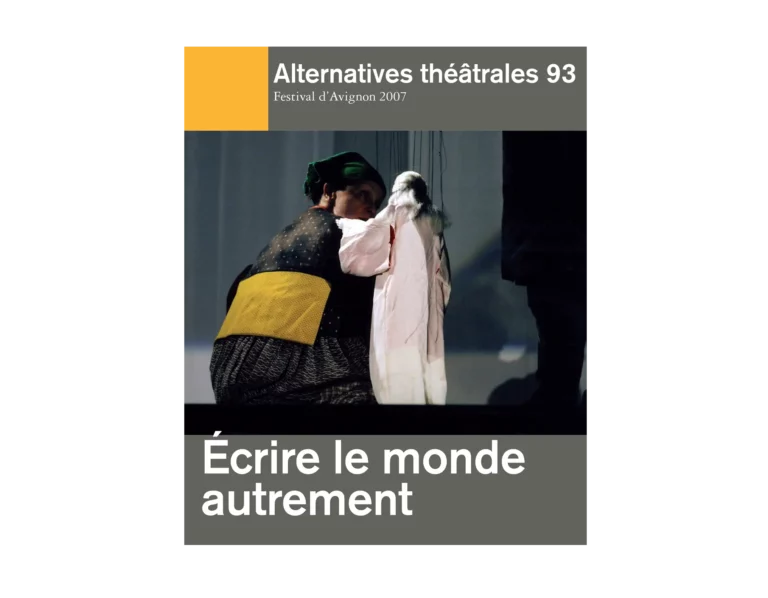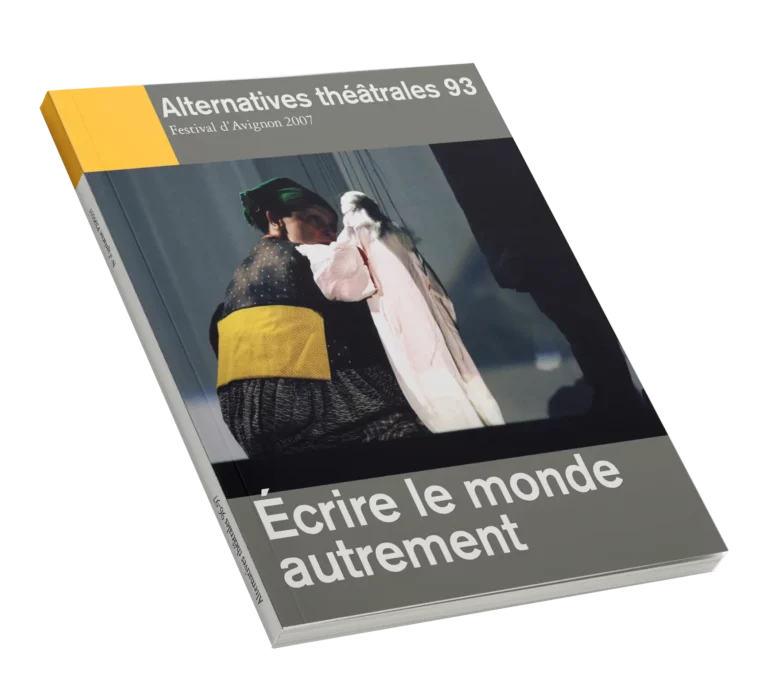SYLVIE MARTIN-LAHMANI : Valère, tu as déjà une longue histoire avec le Festival d’Avignon. Cette création est la neuvième. Depuis 1986, vous y avez joué LE DRAME DE LA VIE, VOUS QUI HABITEZ LE TEMPS, L’OPÉRETTE IMAGINAIRE (mise en scène de Claude Buchwald), L’ORIGINE ROUGE, LE DISCOURS AUX ANIMAUX ainsi que L’INQUIÉTUDE par André Marcon. Mais c’est la première fois que vous investissez la Cour d’honneur du Palais des Papes ?
Valère Novarina : C’est vrai. Avec Vincent Baudriller, nous avons visité plusieurs lieux qui m’attiraient pour des raisons semblables et différentes : notamment la carrière Boulbon parce qu’il y avait ce mur de pierres, cette simplicité, ce rapport avec la nature, les cailloux. Dans la Cour d’honneur, ce n’est pas le mur de pierres qui m’a attiré, c’est le mur humain, en face des acteurs. Entre le mur de cailloux et le mur humain, Vincent a choisi de m’envoyer face au mur humain. Mes textes sont faits par le lieu. Le travail d’écriture germe à partir d’un lieu. Le lieu de la création est donc tout à fait important pour la pièce. J’ai écrit la première version de L’ESPACE FURIEUX pour le Théâtre de la Bastille. Les murs de la Bastille ont écrit la pièce. Les Carmes ont écrit LA SCÈNE. L’ORIGINE ROUGE avait commencé à s’écrire pour Boulbon, et finalement c’est devenu Les Carmes. Le lieu est très présent : le croisement du langage avec l’espace, l’endroit du re-croisement du langage à l’espace. Le langage est un fluide, une matière qui sort des corps et se répercute différemment selon les lieux. On entend différemment selon les lieux, selon les murs et selon la masse humaine. Il me semble qu’on ne doit pas entendre la même chose à deux mille qu’à trois cents. Je n’ai pas encore l’expérience de la Cour d’honneur, mais cette multitude humaine en face est attirante. Je me suis souvenu que ce qui m’attirait dans ce mur humain venait de loin : quand j’étais petit, entre l’âge de zéro et dix ans, j’habitais à côté du stade Joseph Moynat à Thonon. Il y avait une tribune parfois remplie, parfois vide, remplie d’humains, vide d’humains. Quand j’ai visité la Cour la première fois, j’ai préféré y aller seul, pour voir le vide de l’endroit. Dans le fond, ce qui m’intéresse, c’est que ce n’est pas seulement un endroit grand ; c’est un endroit creux, un endroit de creusement. Louisa Mitsacou m’a appris récemment que dans le théâtre grec, l’endroit du public, c’est l’endroit où on creuse la colline à Épidaure. L’endroit du public s’appelle kiléon, c’est-à-dire le « creux du public ». C’est l’idée que le mur humain est un mur creusé, comme tous les murs d’ailleurs. À Jérusalem, le Mur des lamentations aussi est creusé puisqu’on peut y mettre des messages. Dans un mur, il y a des failles… C’est ce que j’ai ressenti quand on a joué à la Comédie-Française car c’est un endroit où il y a un public populaire. Il y a peu d’endroits où le public est mélangé. J’ai été étonné de découvrir qu’il y avait un tel brassage humain à la Comédie-Française (des Japonais de passage, des kinésithérapeutes de Carcassonne, des gens des banlieues…). Il y a un vrai mélange humain. Quand il y a une multitude, il se passe quelque chose de différent : un phénomène thermique dans le public, le miroitement des regards. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le rapport au public, mais le rapport à chaque spectateur individuellement. Ils sont rassemblés et touchés par des choses différentes, chacun. Des flèches partent du spectacle et chaque spectateur reçoit un projectile différent. Il y a une balistique du langage où les mots, les phrases existent, comme énergie opérante. Cet endroit, ce n’est pas rien. La nature va s’en mêler. Il peut pleuvoir, venter. J’ai dit à mes acteurs que cette fois-ci, on n’allait pas sur le lac de Neufchâtel, mais faire un tour au Cap Horn, avec nos petites embarcations. Il y a un danger marin qui vient de l’assemblée humaine et du temps. Le côté « expédition » de la chose n’est pas pour me déplaire.
S. M.-L. : Dans LUMIÈRES DU CORPS1, il est dit : « L’acteur procède au lancer du langage : comme des dés dans l’air, les mots sont des rébus à six faces qui tombent sur l’une seulement. » Que deviendront les mots de ta nouvelle création lancés dans le grand espace de la Cour ?
V. N. : Je n’en sais rien et c’est ce qui est assez intéressant (Rires). Je ne m’adapte pas à la Cour d’honneur, cependant elle est là. Ce texte s’appelle L’ACTE INCONNU, justement pour qu’on ne pose pas de question. Il est écrit depuis longtemps, depuis la fin de LA SCÈNE en 2003. J’avais un chantier ouvert qui attendait sa matrice, son architecture, son lieu. Quand Vincent Baudriller m’a fait cette proposition, le vrai travail a commencé. L’entrée en matière. Cette pièce a souvent changé de titre. Elle s’est appelée COMÉDIE CIRCULAIRE, c’était un titre de guerre ! Mais j’ai fait circuler un certain nombre d’autres « faux » titres : ça s’est appelé LA PAROLE PORTANT UNE PLANCHE, ça s’est appelé L’ÉTOILE DES SENS, ça s’est appelé L’AMOUR GÉOMÈTRE, L’HOMME HORS DE LUI… Et, graphiquement, j’ai préféré L’ACTE INCONNU.
S. M.-L. : Parmi les faux dossiers que tu as fait circuler, j’en ai un qui parle d’« Archipel d’actes ». C’est ainsi que la pièce est structurée ?
V. N. : Bien sûr, il y a de la vérité dans tous ces faux. Cette pièce est construite en quatre actes et c’est très important. Le chiffre 4 est intéressant : un, c’est un point ; deux, c’est une ligne ; trois, ça détermine une surface et quatre, c’est l’apparition du volume. C’est l’apparition de la matière, de la matérialité, des choses qu’on peut toucher. Dans LA SCÈNE, il y avait un acte qui s’appelait « l’acte inconnu ». Et j’aimais dire aux acteurs, à chaque fois que nous y arrivions : « Alors là, nous arrivons à l’acte inconnu ! Et on ne sait pas ce qui va se passer… » J’aime beaucoup cette idée qu’on ne sache pas ce qui va se passer. C’est aussi l’inconnu de cette rencontre avec cet endroit autre.
S. M.-L. : Dans LUMIÈRES DU CORPS, au chapitre « L’Acteur sacrifiant »2, tu dis : « Chaque fois qu’un acteur entre, de l’homme apparaît offert et sans aucun sous-entendu humain. » Tes scènes sont pleines d’entrées d’acteurs, d’acrobates, de danseuses « lançant leur corps ». Qui va entrer dans L’ACTE INCONNU ?