1.
EN 1999, L’ÎLE DES MORTS de Strindberg et LE GARDIEN DE TOMBEAU de Kafka, que Frédéric Fisbach avait associés en un montage qui insérait la seconde pièce à l’intérieur de la première, offrait la succession de deux modes de théâtralité bien différents. L’ÎLE DES MORTS, qui ouvrait le spectacle, recourait à des jeux rudimentaires d’ombres et de projections sur un rideau tiré à l’avant-scène, devant lequel était ensuite joué, face public, le dialogue entre Assir (Frédéric Fisbach), nouvel arrivant au royaume des morts, et le Professeur (Margaret Zenou) qui l’interrogeait pour lui faire reconsidérer sa vie. Sa représentation instaurait avec le spectateur un rapport de proximité et de frontalité, le plus simple qui soit, dans lequel les fréquents regards de connivence du Professeur au public venaient confirmer une adresse directe et ostensible. La représentation du GARDIEN DE TOMBEAU, par contre, se retirait ensuite sur la scène, séparée par un cadre de fenêtre suspendu dans le vide (derrière lequel Assir se cachait pour assister à cette seconde pièce, censée lui être représentée), et s’avérait régie par un certain nombre de codes particuliers (diction, chevauchement des fins et débuts de répliques, regards…). Elle baignait, du fait de ces effets et d’autres – sonores, lumineux… tous de facture simple, cependant – dans une « inquiétante étrangeté », celle du monde fantastique posé par la pièce de Kafka, monde dont les lois non « naturelles » semblaient bien échapper à notre appréhension. Se succédaient ainsi une représentation plus ou moins « de bric et de broc » dans un rapport d’adresse frontale au public, et une représentation fortement formalisée qui semblait comme se retirer en elle-même pour développer sa cohérence propre, son autonomie, son intégrité, et obligeait alors le spectateur à réinvestir autrement sa relation au spectacle. D’une certaine manière, cette succession témoignait d’une dualité qui est toujours à l’œuvre dans l’esthétique scénique de Fisbach : cette esthétique oscille en effet entre la simplicité d’une théâtralité minimale et affichée, celle d’une adresse et d’un ludisme ostensibles, et l’élaboration de dispositifs formels rigoureusement réglés, établissant leurs propres logiques internes avec lesquelles le spectateur est alors amené à se familiariser progressi- vement. Deux modes de théâtralité qui ne s’opposent pas chez Fisbach, mais se complètent et jouent ensemble pour construire le rapport de l’œuvre à son spectateur.
2.
À la base de cette alliance entre ces deux pôles, chez Fisbach, il y a avant tout la langue, l’écriture. En cela, le metteur en scène prolonge d’ailleurs, tout en le déplaçant, le travail d’acteur qui avait pu être le sien dans les spectacles de Stanislas Nordey. La mise en scène part de l’écriture, elle est en premier lieu une invitation à traverser la langue propre à un auteur, et Fisbach se plaît à aborder le texte comme une partition, comme une forme singulière dans laquelle l’ensemble des interprètes doivent se glisser avec rigueur pour la transmettre – l’adresser – au spectateur. Il peut d’ailleurs arriver que, discrètement, la présence du livre-partition vienne s’inscrire sur la scène, comme c’était le cas à la fin de L’ANNONCE FAITE À MARIE (la chanteuse, regardant le public, livre en main et sourire aux lèvres) ou, plus récemment, dans la deuxième partie des PARAVENTS, lorsque les vociférateurs se retrouvaient sur la scène ; ou encore, comme c’était le cas dans une séquence de L’ILLUSION COMIQUE, quand une partie du texte était projetée en fond de scène. Avant même d’être diffracté en voix de personnages, c’est le texte comme poème global qui est premier : il était ainsi tout naturel que BÉRÉNICE s’ouvre par la prise en charge chorale (enregistrée et diffusée sur un petit lecteur audio placé aux premiers rangs) des premiers vers du texte de Racine. Et c’est l’écriture, avant tout, qui dicte et produit la forme : comme plus tard, entre autres, TOKYO NOTES, BÉRÉNICE, ou encore, en japonais, GENS DE SÉOUL, la mise en scène de L’ANNONCE, acte initial, en témoignait exemplai- rement, dans son traitement du verset claudélien comme unité de souffle plus que de sens, et avec l’instauration de codes de diction très stricts (diérèses, prononciation des « e » muets, absence de liaisons…) destinés à le faire entendre dans toute la matérialité de son écriture. Et c’est à travers le parcours émotif construit par ce qui peut paraître dans un premier temps comme une mise à distance de l’écriture – une exhibition de sa forme – que s’établit alors un rapport sensible à celle-ci.
Mais ce travail de l’écriture ne serait pas sensible, justement, s’il ne se jouait pas dans le passage de cette parole à travers le corps des interprètes, la manière dont ceux-ci la laissent résonner en eux, si celle-ci ne prenait toute sa densité sensible à travers leurs voix (et parfois leurs accents), leurs souffles. C’est d’ailleurs un motif discret mais essentiel que le travail sur le souffle, que l’on retrouve dans nombre de spectacles de Fisbach : c’est l’unité de souffle du verset claudélien (également partiellement transposée pour le vers racinien), là encore, ce sont les paroles parfois comme expirées et les respirations audibles du GARDIEN DE TOMBEAU, ou les corps épuisés par un premier acte dansé extrêmement physique, qui prenaient en charge l’alexandrin de BÉRÉNICE… Langue ciselée comme celle de Racine, lyrique comme celle de Claudel, ou au contraire langue malade, minée, révélant en creux les fissures de l’être, par ses heurts et sa dislocation comme dans ANIMAL de Roland Fichet, ou par un épuisement plus souterrain comme dans le TOKYO NOTES d’Oriza Hirata, sans parler du chant de l’opéra : la langue traverse et habite le corps des interprètes, que ceux-ci soient presque immobiles, debout sur une table ( L’ANNONCE FAITE À MARIE ) ou sur un petit praticable ( L’ILLUSION COMIQUE ), ou parfois au contraire entraînés, comme par cette langue même, dans une agitation extrême et comme incontrôlée (Nil – Wakeu Fogaing – dans ANIMAL, par exemple). Si Fisbach insiste en permanence, dans son travail, sur la non fusion entre l’interprète et le personnage, c’est certes par refus du naturalisme et pour créer des « écarts » entre les éléments de la représentation, mais c’est sans doute aussi pour que soit visible cette prise en charge intime, par chaque corps singulier, d’une écriture que la formalisation de la diction, d’autre part, manifeste comme encore plus commune à l’ensemble des acteurs. Et si les spectacles les plus récents insistent moins sur l’établissement de contraintes globales de profération du texte au profit d’une plus grande hétérogénéité des approches, c’est pour d’autant plus manifester les corps-à-corps singuliers de chaque interprète avec le texte. LES PARAVENTS, pour ne prendre que cet exemple, montrait ainsi d’un côté la performance vocale des deux vociférateurs (Valérie Blanchon et Christophe Brault ), traversée au long cours et jeu de multiples variations pour donner voix à près d’une centaine de personnages, et, de l’autre, avec les interprètes de la famille des Orties, trois rapports bien différents à la langue de Genet, entre la lutte énergétique que menait avec elle Laurence Mayor (la Mère), la simplicité légèrement distante de Giuseppe Molino (Saïd), et l’abord par le chuchotement et l’intime de Benoît Résillot ( Leïla) : trois modes d’appropriation singuliers de l’écriture de Genet par des corps et des jeux différents. La parole engage le corps dans ce qu’il a de plus intime, s’incarne par lui et le travaille en retour.
3.
Dans certains spectacles, il arrive que la voix soit relayée par des micros, qu’il s’agisse du micro suspendu autour duquel se jouait le dialogue entre Paulin et Titus au deuxième acte de BÉRÉNICE (séquence dite « de la radio »), ou des micros HF, auxquels Fisbach recourait dans LES PARAVENTS, et auquel il recourra à nouveau dans les FEUILLETS D’HYPNOS. Un tel usage joue alors sur deux niveaux : s’il est un moyen d’amplification servant l’audibilité et donc l’adresse de la parole, il permet surtout un travail d’acteur plus intime, plus ténu et replié sur lui-même puisque dégagé des nécessités de la profération (le personnage de Leïla dans LES PARAVENTS en était un exemple manifeste); il permet de jouer sur une « intériorité » singulière, à laquelle il donne accès tout en la colorant (c’est le propre de la texture sonore produite par l’amplification, qui peut d’ailleurs participer également d’un travail plus global sur le son, à l’image de celui créé par Thierry Fournier pour LES PARAVENTS ) d’un léger effet de distance et d’étrangeté. L’adresse et la clôture, là encore. La « matière » sonore propre au micro pourrait d’ailleurs être rapprochée d’autres matières que l’on retrouve dans plusieurs de ses spectacles (sans parler des lumières de Daniel Lévy): la bâche plastique qui séparait Violaine et Mara (Valérie Blanchon et Stéphanie Schwartzbrod) dans L’ANNONCE…, et derrière laquelle se jouait ensuite la fin de la pièce ; les panneaux de verre dont les déplacements reconfiguraient régulièrement l’espace de BÉRÉNICE ; ou encore les vitres de la cabine téléphonique de la fin d’ANIMAL. Autant de matières jouant à la fois de la transparence et d’une séparation ; autant de matières diffractant et décalant légèrement le regard et l’écoute.
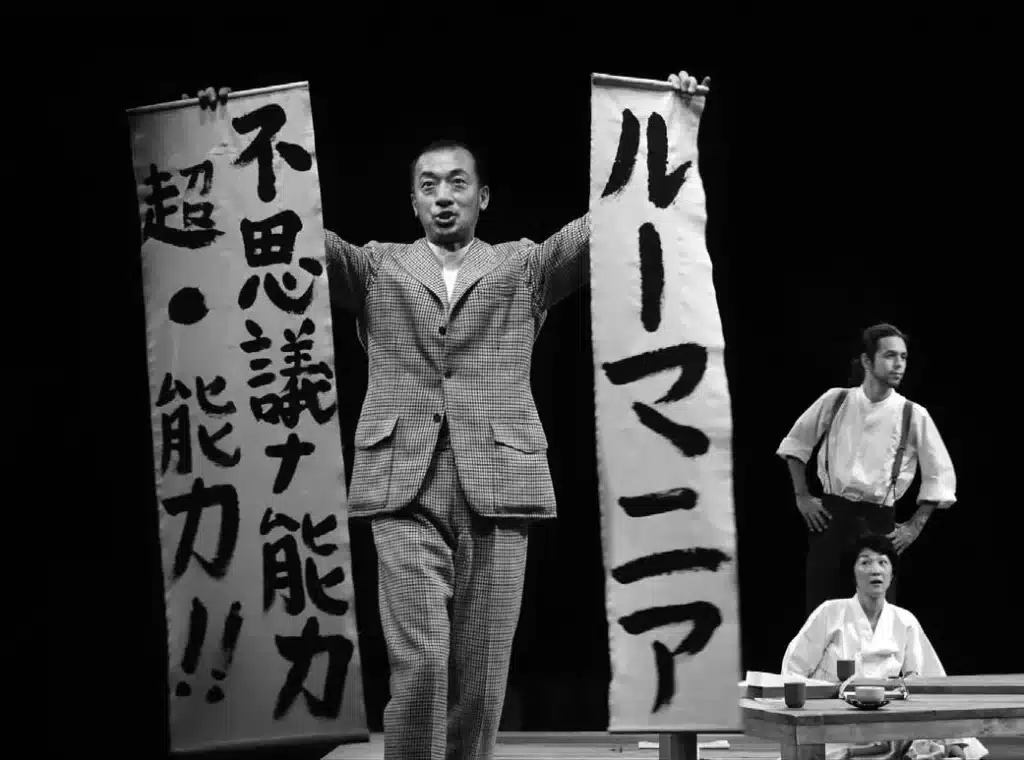
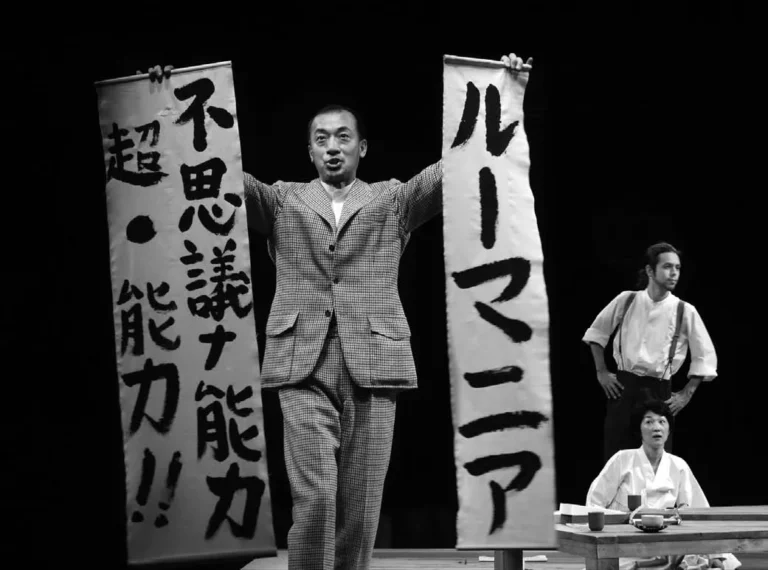
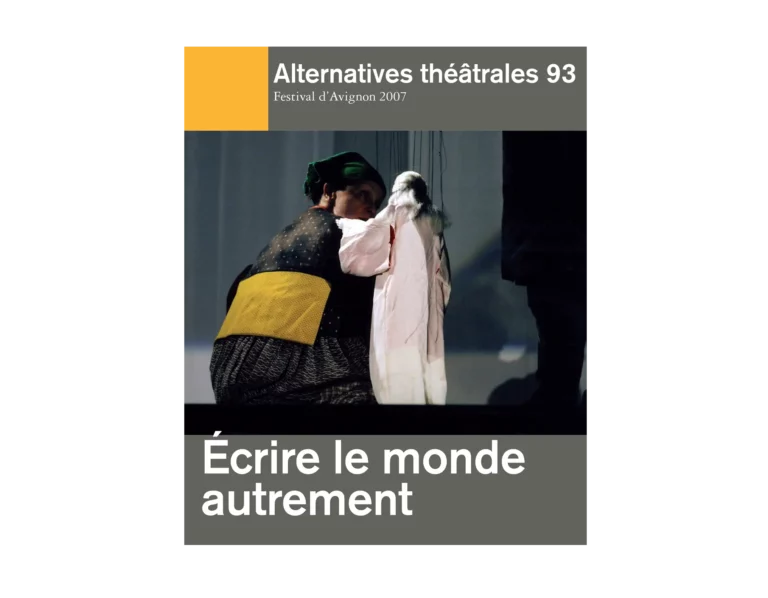
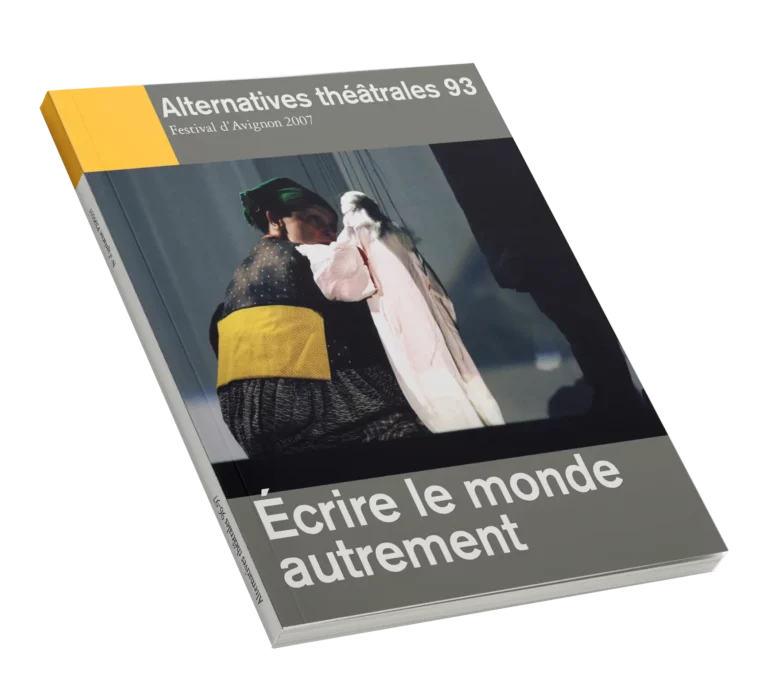



![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)
