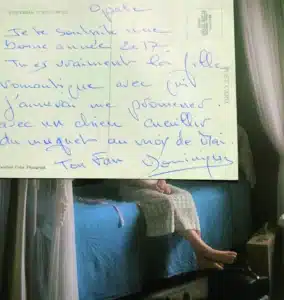Sylvie Martin Lahmani : Comment définiriez-vous votre travail de création artistique, envisagé à l’aune de la « diversité culturelle » ? Et que revêt selon vous ce terme devenu d’usage courant au sein des institutions culturelles ?
Chantal Loïal : Je mène, depuis vingt ans, avec ma compagnie, un travail de fond porté par des choix esthétiques singuliers, mais également une force d’engagement sociétal et citoyen, en résonance sensible avec l’idée forte de “créolisation” qui, selon Edouard Glissant, “n’est pas une simple mécanique du métissage : c’est le métissage qui produit de l’inattendu.” Cette “troisième” voie, celle de la créolisation, entendue comme “identité multiple”, ouverte sur le monde et la mise en relation des hommes, des cultures et des imaginaires apporte des réponses réalistes et pragmatiques aux problématiques contemporaines du vivre et de l’agir ensemble.
Au terme “diversité”, galvaudé et réducteur à mon goût, notamment en matière culturelle, je préfère l’idée d’ ”altérité” qui interroge plus profondément les notions de stéréotypes, spécificités culturelles et/ou sociales et attise la curiosité vers des espaces de découverte riches et ouverts. Car c’est bien le dialogue avec l’autre et l’ouverture au monde qui doivent être privilégiés à mon sens et non un échantillonnage ou saupoudrage de façade.
S. M.-L. : Avez-vous le sentiment de subir, à titre personnel, une inégalité de traitement en tant qu’artiste issu de l’immigration ; ou d’être victime d’une forme de stigmatisation, voire de ségrégation culturelle qui ne s’avoue pas en tant que telle ?
C. L. : Je suis une artiste d’origine antillaise, donc française, je ne suis donc pas considérée comme “issue de l’immigration” au sens actuel. Cependant, à travers mon travail, je porte les couleurs de ma culture et de ma communauté.
Le travail que je mène, les thème que je choisis, puisent dans mes racines et sont parfaitement assumés, avec les risques qu’ils comportent, c’est-à-dire un accueil parfois réticent à voir aborder des sujets jugés « sensibles », qui pointent du doigt des facettes peu glorieuses de notre histoire commune ou de nos schémas mentaux tels que l’esclavage ou la discrimination. Cette frilosité peut s’accompagner également, selon les publics, d’une attente non satisfaite de retrouver les stéréotypes de ce que l’on pourrait désigner sous le terme de « doudouisme » , c’est à dire un folklore ultra-marin réduit à sa stricte part d’exotisme « positif » et réducteur, au détriment de pans entiers de la culture transatlantique probablement moins confortables pour de nombreux programmateurs ou institutions culturelles.
S. M.-L. : Plus généralement, les artistes issus de l’immigration souffrent-ils d’un déficit de visibilité sur les scènes européennes ? Ou au contraire d’une forme de promotion partisane et militante ?
C. L. : Quand promotion il y a, pour nous, artistes qui travaillons au long cours, ces coups de projecteurs médiatiques et/ou politiques sont vécus en tant que tels, comme “faits du Prince” et retombent bien souvent comme des soufflés. Pour preuve, à notre échelle, l’ ”Année des Outre-mer”, lancée en grande pompe en 2011. L’objectif officiel était bien sûr de mieux faire connaître la variété et la grande richesse des populations, des cultures et des territoires d’Outre-Mer. Dans notre domaine, la danse contemporaine, aucun événement majeur n’a été programmé sur les grandes scènes publiques, la majorité des spectacles liés à cet événement ayant été relégués à de plus petites scènes, essentiellement faute de budget dédié à la promotion de ces cultures, même pour cette année 2011. En termes de “gain en visibilité”, le bilan de cette opération est très mitigé.
Parallèlement, pour des projets récents plus ambitieux portant sur la culture africaine, des compagnies comme la mienne en sont exclues par principe, du simple fait par exemple de leur domiciliation en métropole et non aux Antilles, malgré les liens unissant ces deux cultures.
Dans ces processus pyramidaux émanant des autorités ministérielles, il devient très difficile de “décentraliser” les thématiques, dès lors que les volontés politiques s’imposent avant tout à travers les budgets dédiés à leur soutien.

S. M.-L. : Peut-on dire que le spectacle vivant en France est encore prisonnier d’un « système d’emplois » d’autant plus efficace qu’il ne se déclare pas comme tel, voire qu’il n’a pas conscience de lui-même ?
C. L. : Le “communautarisme”, d’après ce que je vis professionnellement, est beaucoup plus palpable, à mon avis, au niveau des institutions culturelles. Celles-ci cultivent, consciemment ou non, un entre-soi figé qui exclut de fait ceux qui en maîtrisent mal les codes ou ne font pas partie des communautés sociales qui en constituent les instances décisionnelles, et auto-entretiennent un conformisme de bon aloi, souvent sous un faux prétexte de “politiquement correct”.
Avec maintenant entre 50 et 80 représentations par saison à notre actif, et un succès croissant depuis 20 ans tant auprès des publics que des média, sans avoir bénéficié à ce jour d’aucun conventionnement, je crois plus que jamais à la légitimité de notre place dans le monde de la danse contemporaine et me réjouis rétrospectivement de ne pas avoir dû renoncer à ce qui fait ma force et la raison d’être de ma compagnie.
À mes récentes demandes de soutien à la création, il m’a été opposé que priorité était donnée à l’ ”émergence”. Puisqu’il semble qu’un renouvellement soit décidé et fortement encouragé dans les propositions culturelles, comment les instances décisionnelles qui précisément ont la prétention de construire le monde culturel de demain, pourraient elles-mêmes s’affranchir de ce “rafraichissement”, ne pas reconsidérer leur système de fonctionnement et ne pas s’interroger sur leur légitimité, elles-aussi ?
S. M.-L. : Peut-on y voir la résurgence d’une histoire du théâtre marquée par son incapacité à penser l’altérité, comme le montrent les spectacles exotiques, freaks shows ou slide shows, dont Sarah Baartman la « vénus hottentote » ou « vénus noire », le clown Chocolat et la danseuse Joséphine Backer ne sont que les figures saillantes ? Comment vous situez-vous par rapport à ces artistes pionniers cantonnés dans des rôles racisés, voire complètement essentialistes ?
C. L. : Dans l’inconscient collectif, ces figures “clichés” sont un point de départ intéressant, à conditions bien sûr de s’en servir comme “catalyseur”, pour amener le public à s’interroger dans un premier temps sur l’utilisation qui a été faite de ces stéréotypes, puis sur ses effets pervers.
L’humour et le beau : dédramatisation, pas de “culpabilisation” mais on ne peut pas être toujours dans le consensuel, sortir des dénis, des refus de mémoire et ré-instiller de l’humanité dans des situations qui en semblaient privées. Faire vibrer cette fibre humaine dans les personnages réincarnés, et jouer de la contagion avec le public.
(…)
La suite de cette entretien est disponible au format PDF.