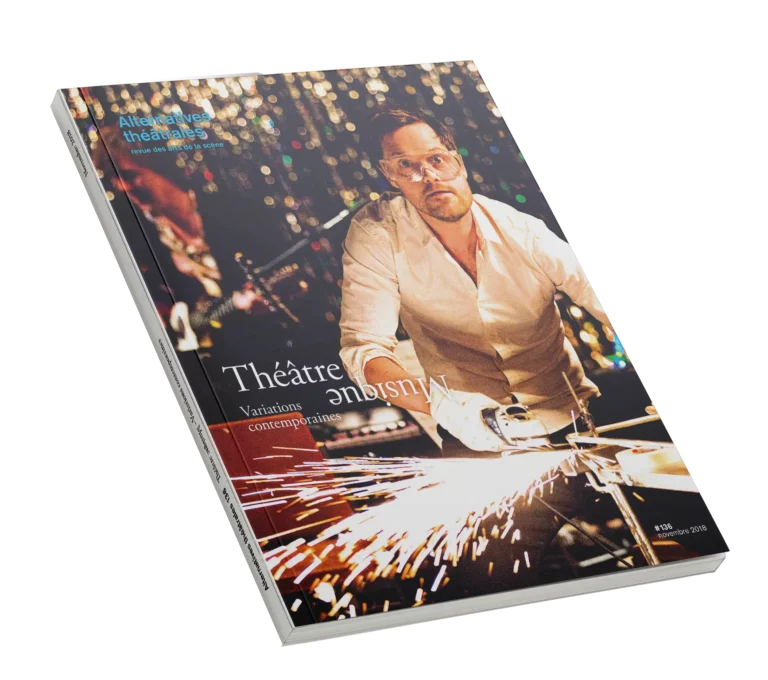Que Christoph Marthaler soit une figure majeure du théâtre musical ne fait aucun doute. Tous les indices sont là : une formation classique en hautbois et en flûte, des débuts en tant que compositeur de musiques de scène pour des compagnies théâtrales indépendantes et comme free jazz man dans les brasseries bâloises, puis rapidement le développement de créations portant sur la scène des acteurs-chanteurs à la virtuosité certaine. Déjà, Indeed, en 1980, annonçait la couleur : rassemblant acteurs et musiciens dans une usine, ce qu’il qualifiait d’« action musicale » proposait un collage de textes dadaïstes et de prospectus et publicités. Soit le premier état d’un théâtre musical qui réinvente inlassablement sa forme. Reste que cette étiquette de théâtre musical est insuffisante pour définir le travail de celui que ses camarades définissent comme « moitié musicien, moitié horloger suisse1 ». Insuffisante, car elle laisse penser que cet équilibre (toujours instable) entre musique et théâtre constitue le cœur de son travail là où il est un maillon, essentiel certes, mais au service d’une mécanique propre. Il faudrait alors se détacher de ce qui saute aux yeux et aux oreilles, de ce mélange entre théâtre et musique pour observer ce qu’il recouvre. Dépasser l’apparente légèreté et fluidité burlesque des spectacles de Marthaler, en gratter un peu le vernis joyeux pour percevoir une nostalgie et une mécanique de l’échec. Dans ce monde désœuvré, théâtre et musique apparaissent alors comme les meilleurs langages possible, faute de pouvoir dire ou écrire autrement ces expériences poétiques au cœur des spectacles de Marthaler.
Au détour d’une conversation avec Olivier Cadiot pour le Festival d’Avignon, le metteur en scène suisse avoue ainsi : « Moi, je ne peux pas écrire, et même presque pas parler : j’ai donc besoin d’un autre langage, comme la musique ou le théâtre, qui m’aide à trouver des images pour comprendre le monde. Rien d’autre… alors je peux raconter des histoires. On parle également de temps à autre dans ces histoires, mais il s’agit avant tout d’images. Des images d’êtres humains dans des situations particulières. Tout le reste est une… feinte, surtout les titres des pièces. »2
Lorsque la parole échoue et vient à manquer, théâtre et musique prennent le relais. Loin de construire des tableaux figés à contempler, ces images nées de l’échec des gestes et des mots sont fugitives et placent le spectateur (et l’acteur) « devant le temps », pour emprunter l’expression de Georges Didi-Huberman. Images de chœurs démunis qui, parlant et chantant, font surgir au creux d’un monde nostalgique le parfum de souvenirs à partager.
Images de chœurs démunis
Qui a vu un spectacle de Christoph Marthaler garde en mémoire ce rythme étrange instauré par un théâtre où des choralités parlées, chantées ou simplement sonores se succèdent les unes aux autres, entrecoupées de scènes de suspens silencieuses ou instrumentales. L’enchaînement théâtre/musique suit à première vue une structure rythmique savamment mise au point par le metteur en scène et dans laquelle l’un retarde l’autre alternativement. Ainsi de la scène du thé dans le spectacle Les Spécialistes, création qui met en scène une dizaine de cadres qui suivent un entraînement rhétorique intense et, bien entendu, absurde. Dans un salon de bois, les hommes en costumes sont ainsi alignés le long des murs, devant des micros et répètent inlassablement leur discours dont les spectateurs ne saisissent que quelques bribes au travers de cette cacophonie parlée. Soudain, une sonnerie interrompt ce chœur parlé que le titre du spectacle désigne comme un « entraînement mémoriel pour cadre » : première coupure rythmique, plus aucun mot n’est prononcé, les gestes prennent alors le relais. Chacun emporte avec soi sa tasse blanche, sa soucoupe tenue bien droite et sa petite cuillère. Tout en exécutant ces gestes d’une banalité soutenue et chic, ils chantonnent une douce mélodie, lèvres fermées, et font face au public. À la cacophonie parlée fait suite une première chorégraphie de gestes minimaux et sociaux, que ces murmures chantés accompagnent alors. Les corps des cadres sont serrés dans leurs costumes de cadre, ils prennent tous un air inspiré, comme transportés par cette mélodie qui fait doucement vibrer leur poitrine. La musique prend fin à son tour. Ils boivent tous, de concert, leur tasse de thé, la reposent dans un même geste sur la soucoupe blanche et, ouvrant enfin la bouche, laissent échapper un soupir de soulagement prolongé qui surprend et provoque des rires. Paroles, gestes, chant murmuré : on attendrait à la suite de ce mouvement crescendo un chant choral virtuose et pourtant c’est un soupir d’une banalité et d’une trivialité étonnantes que l’on entend et qui suscite l’hilarité. Façon pour le metteur en scène de décaler la représentation et de briser toute image esthétisante au moment précis où elle se forme. Et, de fait, les choralités s’enchaînent et s’emballent peu à peu pour retrouver la cacophonie qui précédait cette pause-thé : les hommes, gardant leur tasse à la main, se mettent à discuter entre eux. Ou plutôt échangent des phrases, comme on échangerait des objets de collection. Simulacre de discussion créé par les gestes, les postures et les intonations davantage que par le contenu des propos tenus. Après les chœurs de mélodie murmurée, de gorgées de thé englouties puis de gestes synchronisés, les paroles semblent être autant de notes que l’on envoie dans la mêlée en espérant qu’elles tomberont bien et formeront une harmonie.
Si cette scène illustre bien comment les choralités chantées, gestuelles et parlées des spectacles de Marthaler retardent le déroulement de la représentation en jouant sur les ruptures de rythme, quelque chose d’autre s’y joue qui dépasse la seule logique spectaculaire. Dans le processus de création du spectacle en lui-même, le chant choral construit entre les acteurs-chanteurs/personnages un tissu théâtral particulier à partir duquel, par la suite, le spectacle pourra se structurer. C’est ce deuxième aspect de la choralité dont témoigne Stefanie Carp, la dramaturge qui accompagne Marthaler depuis 1988, dans un documentaire réalisé sur leur travail : « Chaque répétition commence par le chant. Cela contribue à former le groupe. Quand on chante ensemble, peu importe qui joue le premier ou le second rôle. Le chant choral place les gens à égalité et gomme les différences prétendument importantes. Comme le dirait Christoph, cela crée une communauté de destins, dans un espace donné, dont il est difficile de s’échapper… »3
Si le chant choral est susceptible de créer ainsi, pour Marthaler et les acteurs-chanteurs avec lesquels il travaille, de telles « communautés de destins », c’est que ces destins à nouer ensemble sont ceux d’individus démunis4, de personnages trouvés là et impuissants, dans une attente qui n’a d’autre objet que d’étirer le temps. Lorsqu’ils s’unissent dans un chant choral sur le plateau (et par chant choral, on désigne ici aussi bien une pantomime gestuelle silencieuse menée de concert qu’une effective sonorisation vocale collective), ils désignent dans le même geste le négatif de cette choralité : leur individualité autrement solitaire et perdue dans une errance que viennent distraire l’espace d’un instant ces musicalités sonores et/ou silencieuses. Marthaler prend soin de toujours placer en miroir de ces instants choraux des figures de bord qui désignent négativement le chœur dont elles se sont momentanément échappées.