Prospero :
« J’ai obscurci le soleil de midi, convoqué les vents rebelles et déchaîné la guerre hurlante entre l’océan glauque et la voûte azurée ; j’ai donné feu au terrible tonnerre retentissant et, de la foudre même de Jupiter, fendu le chêne robuste de ce dieu ; j’ai fait trembler le promontoire sur ses fortes assises et arraché par leurs racines le pin et le cèdre ; les tombes ont à mon ordre éveillé leurs dormeurs et, sous l’effet de mon art tout puissant, se sont ouvertes pour leur livrer passage. Mais j’abjure ici cette magie brutale ; quand j’aurai requis une céleste musique (…) je briserai ma baguette, je l’enfouirai à plusieurs brasses dans la terre, et plus profond que sonde atteignit jamais, je noierai mon livre ».
William Shakespeare, LA TEMPÊTE
C’EST donc sur l’ultime parole d’Hamlet — « le reste est silence » — et le dernier mot du Dealer de Koltès — « Rien » — que s’achèvent les huit années de Patrice Chéreau à Nanterre. Est-ce assez dire combien la séparation momentanée qu’il envisage désormais avec le théâtre apparaît significative ? Qu’il y ait là avant tout un choix personnel (il souhaite se consacrer au cinéma) et conjoncturel (il aurait dû mettre en scène Mozart à l’Opéra Bastille) n’y change rien. Si on ne peut s’empêcher d’entendre dans cet au revoir les résonances d’un adieu symbolique — un adieu tchékhovien, ambigu et fervent : « Adieu maison !Adieu la vieille vie, bonjour la vie nouvelle !» —n’est-ce pas parce que toute l’œuvre accomplie à Nanterre nous a fait pressentir un passage par le silence ?
Durant ces années, Chéreau a mis en scène, de plus en plus nettement, la confrontation du théâtre à sa cessation, c’est-à-dire de la parole à son annulation— impossibilité ou inanité. C’est bien entendu le propos commun à HAMLET et à LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON. Mais n’est-ce pas déjà le sujet des PARAVENTS, (dans le spectacle de Chéreau seuls les morts avaient droit à la scène) et de QUARLETT où le désir, source de tout langage, n’a d’autre objet que l’anéantissement (« Ah le néant en moi. Il croît et m’engloutit. Il lui faut sa victime quotidienne » avoue Valmont sous le masque de Merteuil) ? Et que dire de LUCIO SILLA, opéra dans lequel Chéreau se dit fasciné par le silence du personnage central, « étrange et secret, qui ne chante pas, ou si peu » 1 — aphasie vertigineuse et tragique qui permet au metteur en scène d’en faire l’emblème même des hésitations, des contradictions et de la mort de l’opéra séria. Inquiétude et précarité qu’épouse la mise en scène : « Notre plaisir était là aussi : pouvoir faire une mise en scène qui ne donnerait de leçon d’aucun type, et ne serait généralisable à aucun moment, faire un travail, c’est peut-être ce qui agace ou qui déroute, qui ne légifère sur rien (…) un travail sans lendemain. » 2
Rien de plus étranger, donc, à l’idée d’une somme artistique que l’œuvre de Chéreau à Nanterre. Ce qui la caractérise, au contraire, est ce geste toujours répété de dépossession, de dénudation : qu’on compare HAMLET à PEER GYNT, LA FAUSSE SUIVANTE à LA DISPUTE, LES PARAVENTS à LEAR, ou même au cours de son itinéraire nanterrois LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON, à COMBAT DE NÈGRE, LE RETOUR AU DÉSERT à QUAI OUEST : le spectacle se concentre dans Facteur, tandis que le plateau se dépouille et se vide — jusqu’au renoncement, dans HAMLET, à cette verticalité si frappante dans les décors de Peduzzi et qui n’existe plus ici que sous forme de creux, trappe ou tombe.


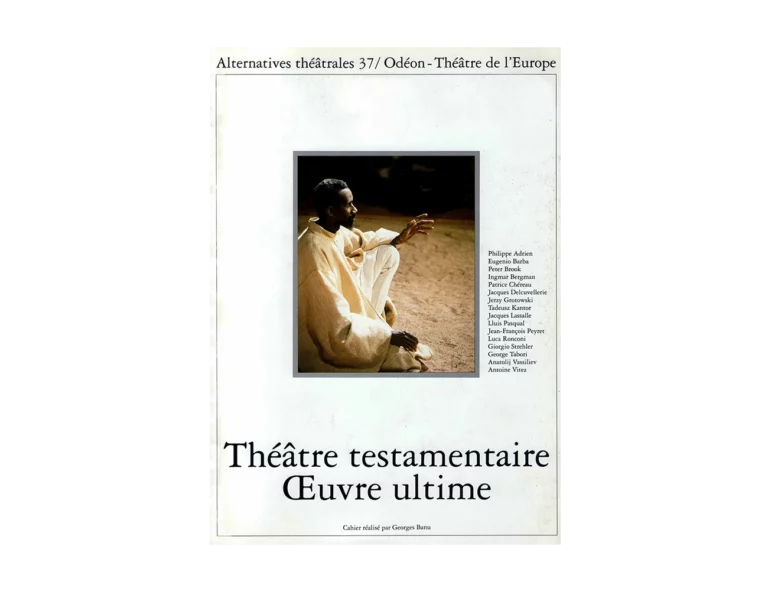
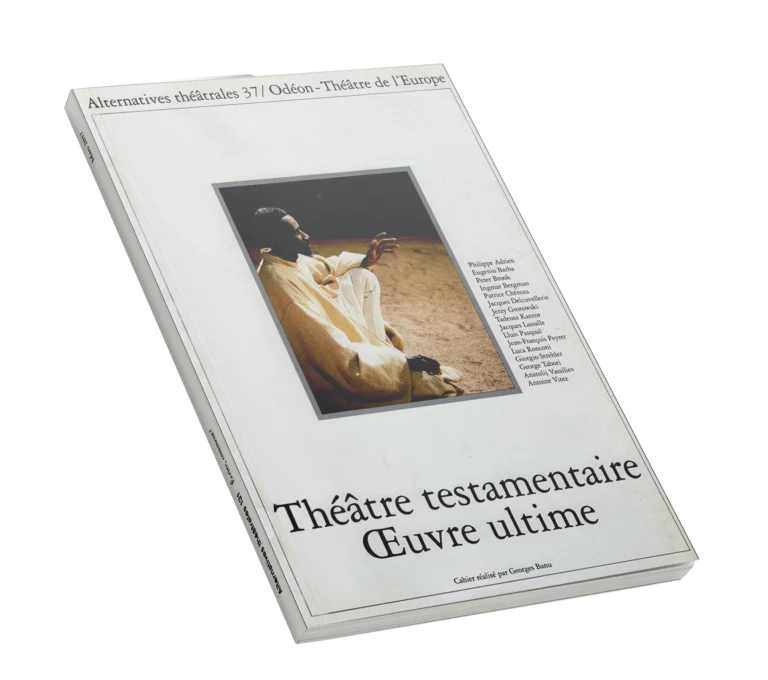
![Lequeu, Jean-Jacques (1757-1826), D’après nature [femme enceinte] : [dessin]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Dapres_nature_femme_enceinte___.Lequeu_Jean-Jacques_btv1b53164350x_1-428x261.webp)