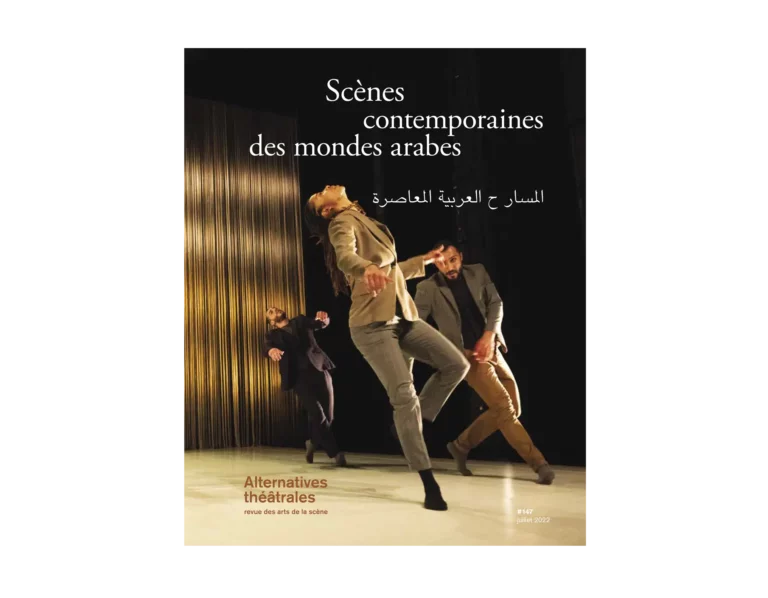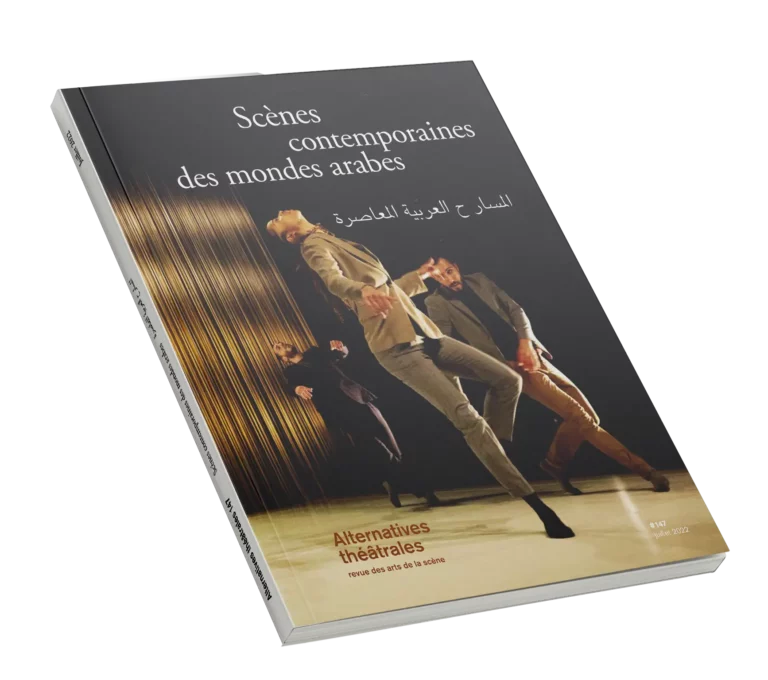« L’origine de Final Cut, ce n’est pas tant la mort de ma mère que le succès d’un racisme politique vécu d’abord de manière intrafamiliale encore enfant. J’en ai pris conscience en 2002, l’année où Jean-Marie Le Pen passait au second tour des élections présidentielles1. »
Nous reviendrons longuement avec Myriam Saduis, autrice, metteuse en scène et actrice, sur l’écriture de Final Cut, sur ses origines familiales complexes et sur sa mise en scène qui met à distance le personnage qu’elle incarne, et dont elle dit : « C’est moi et ce n’est pas moi, c’est mon texte. » Sa prise de conscience politique sonne terriblement juste en 2022. « Ce que j’ai vécu (la folie de ma mère, la négation de mon père arabe et mon changement de nom pour déguiser cette origine) est à replacer dans le flux de l’histoire de l’époque. »
En 2002, une année charnière, sa mère meurt, folle, à l’Hôpital Sainte-Anne à Paris, lui laissant des documents inédits, qui la mènent jusqu’à la famille tunisienne de son père « inconnu ». Elle termine, la même année, une psychanalyse qui lui a permis de se reconstruire, en douze ans. Et elle découvre un scénario inédit d’Ingmar Bergman, Une affaire d’âme, dont elle obtiendra les droits d’adaptation et qui marquera avec éclat, en 2008, ses débuts de metteuse en scène (alors qu’elle avait suivi à l’Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion (INSAS) une formation d’actrice). « Le théâtre précédait la psychanalyse et lui survivra. J’ai fait une longue analyse, je l’ai conclue ; ce qui reste, c’est le théâtre. » Dans un entretien, avec le psychanalyste Yves Depelsenaire, Myriam Saduis dresse, en 2016, les acquis de son long travail de reconstruction. « L’analyse a modifié ma place dans le champ du théâtre puisque je suis passée de ‘faire l’actrice’ à ‘faire de la mise en scène’, et que j’ai endossé une fonction, un pouvoir, qu’on attribue généralement aux hommes… L’analyse a mis l’accent sur le pouvoir réel, celui de la fiction… Je l’ai conclue et puis j’ai monté Affaire d’âme.2 »
Le pouvoir de la fiction
Le pouvoir de la fiction. Et quelle fiction ! Une affaire d’âme : un scénario expérimental d’Ingmar Bergman, conçu comme un long « plan rapproché », une forme nouvelle, jamais réalisée au cinéma. Une femme, guettée par la folie, y ressasse son passé tout en essayant de se reconstruire dans l’imaginaire. Folie, chaos, reconstruction. Il y a comme un « réseau » thématique que Final Cut développera en enquête autobiographique. Ici, la mise en scène de Myriam Saduis transforme le solo de Bergman en un duo intense d’actrices jumelles et com-plices qui multiplient les points de vue en quête d’une improbable vérité. La scénographie joue brillamment sur le rêve plus que sur la réalité.
En 2012, son adaptation de La Mouette de Tchekhov, devenue La Nostalgie de l’Avenir, transforme la grande fresque russe en une petite musique de chambre, centrée sur la trahison de Nina mais surtout sur l’affrontement mère/fils (Arkadina/Treplev). Le fameux texte novateur de Treplev, moqué et donc « nié » par sa mère, est réparti sur l’ensemble de l’œuvre et devient un moteur de l’action. Comme une revanche. Quant à l’inversion de la chronologie (l’histoire commence par le suicide du fils), l’inconscient y a sa part. « C’était une intuition, au départ. Tout d’un coup, je réalise – mais le spectacle est déjà fait – que commencer par le suicide du fils, Treplev, c’est obliger la mère, Arkadina, à interroger par la mémoire ce qui s’est passé. Paradoxalement, en commençant par la mort, l’enfant est plus vivant. Tout cela, je ne le saisis pas quand je décide de commencer La Mouette par la fin, c’est un inconscient qui s’exprime sous couvert d’une intuition. »
Inconscient et faufilage
L’inconscient rôde donc sur la structure narrative. À la fin de son analyse, racontant l’un de ses rêves à son psy, Myriam Saduis s’aperçoit, « après coup, que l’analyse, c’était ça et le théâtre aussi : une ‘déconstruction organisée’3 », ce qu’elle renommera dans Amor Mundi (2015) un « chaos construit4 », pour définir les « irruptions » de pensées d’Hannah Arendt, personnage central de la pièce. Une sorte de « faufilage », revendiqué. « Dans une histoire bien racontée, dit-elle, on joue à la couturière : on tresse et on faufile l’association pour que l’emmanchure ne soit pas de travers. Le cas échéant, on redécoupe, on remet une pièce supplémentaire. À un moment donné, on a le ‘bâti’. Par exemple, dans Final Cut, j’ai introduit une scène de La Mouette. Seule la fiction pouvait me permettre de faire advenir la violence entre ma mère et moi via cette grande scène de dispute entre Arkadina et Treplev. Cette scène est aussi la seule où la mère parle du père, et c’est dans le champ lexical de l’insulte. Pour moi, c’est le noyau : une mère folle, un fils souffrant et un père absent. Dans les associations comme dans les rêves, il y a une logique organique bien plus intéressante que la rationalité. Il faut révéler l’ombre et le secret. »