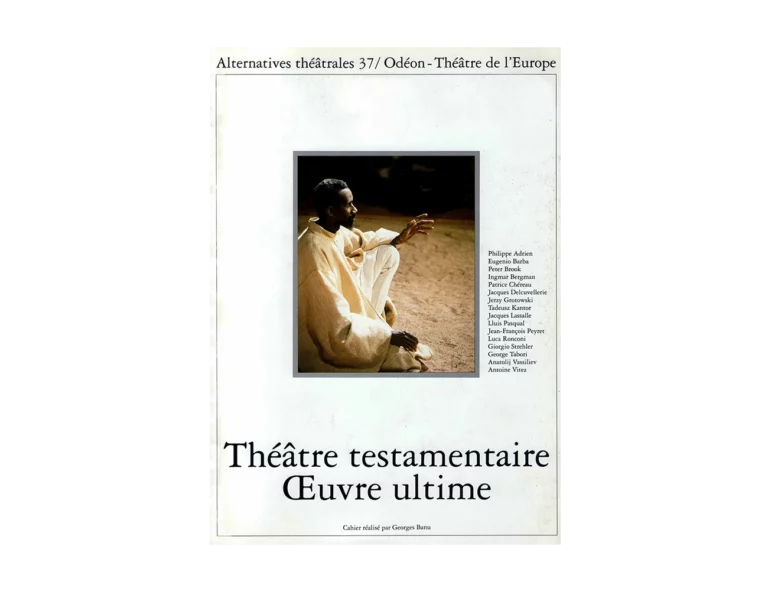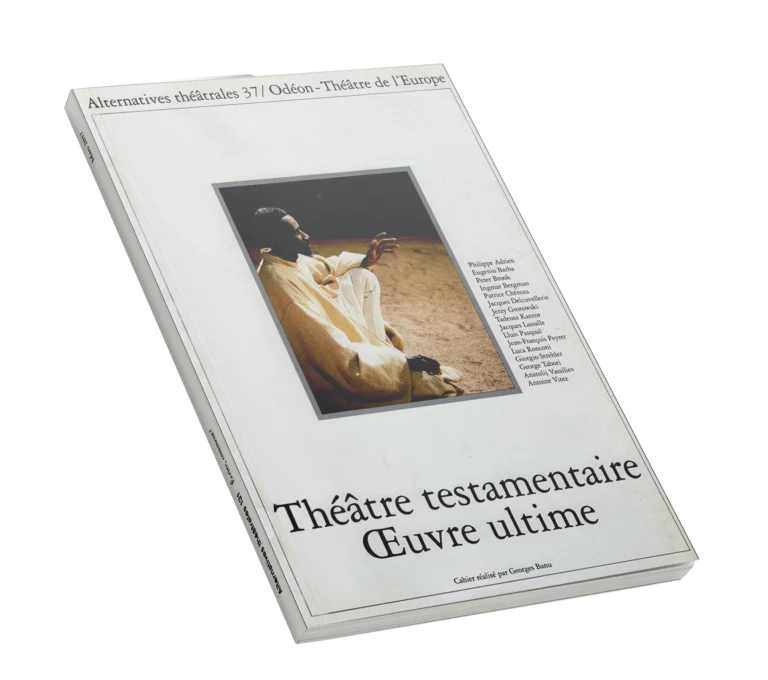ÉVOQUER l’œuvre de Lorca dans un recueil consacré au théâtre testamentaire peut sembler insolite, si l’on entend par théâtre testamentaire « l’œuvre ultime », en laquelle se résumerait toute la pensée ou l’esthétique d’un auteur ou d’un artiste. Sauf à lire les derniers textes de Lorca au regard de son assassinat et donc à solliciter les coïncidences d’une vie devenue « destin », il est difficile de déceler une intention manifeste de transmission post mortem dans ses derniers textes. En outre la dernière pièce de Lorca est, lit-on très souvent, sa pièce la plus classique, c’est-à-dire d’une certaine façon la moins singulière formellement. LA MAISON DE BERNARDA ALBA, que l’auteur désignait lui-même comme un « documentaire photographique », entièrement en prose (seule pratiquement la vieille femme sénile y chante quelques vers), rigoureuse, guidée par une logique sans faille, apparaît comme une œuvre d’une terrible exactitude : de toutes ses pièces la plus sévère, la plus dure, mais dont le classicisme apparent pouvait aussi servir la volonté d’éducation du peuple, toujours revendiquée par Lorca. Ouvrir le théâtre au plus grand nombre a été en effet la lutte constante de toute sa vie de dramaturge et de metteur en scène. Or si transmettre, c’est aussi rendre accessible, la quasi-totalité du théâtre de Lorca peut être définie comme testamentaire.
Plus intéressant est peut-être de s’interroger sur l’existence d’un théâtre spécifiquement testamentaire, qui se distinguerait du reste de la production d’un artiste ou d’un dramaturge par sa forme, son « message », ses conditions particulières de réalisation. De ce point de vue, le théâtre de Lorca est exemplaire et révèle, s’il en était besoin, qu’écrire pour les masses en s’inspirant des formes passées — et chez Lorca les sources sont très diverses : marionnettes andalouses, drame romantique, tragédie grecque, drame tchékhovien, sans parler de Shakespeare et des grands dramaturges du Siècle d’Or … — n’est pas incompatible avec un théâtre d’avant-garde destiné à un public futur. Car Lorca a écrit aussi un théâtre révolutionnaire, complexe dans sa structure, choquant par sa thématique (la validité de l’amour sous toutes ses formes, la tragédie du temps, la révolte sociale), et conçu d’emblée comme posthume. C’est là bien sûr le théâtre véritablement testamentaire de Lorca. « Ces pièces impossibles correspondent à mon propos véritable » affirme-t-il quelques mois avant sa mort au sujet du PUBLIC et de LORSQUE CINQ ANS SERONT PASSÉS. On retiendra le terme d’«impossible » mis en avant par Lorca lui-même, et qui ne se résume sans doute pas à la notion d’«injouable ». Ce théâtre testamentaire naît de l’impossible et se défend de lui. C’est ainsi qu’il devient « le théâtre de l’avenir » 1. Sans doute aurait-il inclus dans ces propos la pièce inachevée, SANS TITRE, qui participe de la même esthétique.
Car s’il y a une spécificité du théâtre testamentaire, ce n’est pas par sa place dernière dans la chronologie, ni même seulement par la densité ou l’achèvement du propos, mais dans l’aspiration à laisser une trace, dans la volonté d’une alliance avec les générations futures. (Et telle est bien l’étymologie du terme « testament », traduisant l’hébreu berith qui signifie « alliance »). Sans doute y a‑t-il plus qu’une coïncidence entre l’existence d’un théâtre testamentaire chez Lorca, et l’omniprésence des thèmes de la fécondité et de la stérilité dans son œuvre. L’enfantement, la première forme de transmission, la plus élémentaire, est en effet sans cesse désiré par les protagonistes, de YERMA à LORSQUE CINQ ANS SERONT PASSÉS, mais pour être toujours invariablement refusé. Et cette frustration majeure constitue l’un des thèmes fondateurs du théâtre lorquien. Car qui dit testament dit héritier, et donc implicitement fertilité. On ne transmet que ce que l’on souhaite voir fructifier. « Le reste n’est que mort immédiate, et il est plus beau de penser que, demain encore, nous verrons les cent cornes d’or du soleil soulever les nuages » 2.
Chez Lorca, ne pas laisser de trace frappe d’anéantissement la vie dans sa totalité. Le présent étant vécu comme une parenthèse, l’existence entière est plongée dans une éclipse. Thème récurrent chez Lorca, l’éclipse élève à l’infini de l’horizon cosmique la métaphore de la stérilité 3. Ainsi par sa vie de vieille fille sans descendance, dõna Rosita, tout en préservant l’illusion d’un temps immobile, est tendue tout entière vers le futur : «… Dans la rue, je vois comme le temps a passé, et je ne veux pas perdre mes illusions. Déjà on a construit une autre maison neuve sur la place. Je ne veux pas savoir comment passe le temps. (…) J’attends comme au premier jour. Et puis, qu’est-ce qu’un an, deux ans, cinq ans ?»
Face à l’impossible arrêt du temps, face à l’illusion stérile qui pousse à vivre dans un hors-temps imaginaire, le testament, lui aussi, est nécessairement inactuel. C’est le discours écrit au présent d’un homme se projetant dans le futur et qui ne peut être lu qu’au passé. S’il pare à la discontinuité du temps, il ne prend sens que par la finitude du présent. LORSQUE CINQ ANS SERONT PASSÉS, œuvre testamentaire qui semble l’application dramatique de cette constatation, « donne à voir, incarné par des personnages symboliques », selon la belle expression d’André Belamich, « ce qui échappe à l’œil charnel : la duperie du présent qui, happé par l’avenir, ne cesse de s’évanouir en fumée de passé » 4. C’est pourquoi ce théâtre-testament, doublement intemporel, bâti « autour de la douleur que nous cause le temps » 5, juxtapose passé, présent et futur, fugacité et permanence, vieillesse et enfance, mort et vie. « Il faut se souvenir », dit le vieillard de LORSQUE CINQ ANS SERONT PASSÉS, dès la première scène et en baissant la voix, comme s’il révélait un secret, « mais se souvenir avant ». Devant la perplexité du jeune homme, il reprend sur un ton confidentiel : « Oui, nos souvenirs doivent se tourner vers demain ». Le vrai théâtre, théâtre à venir, théâtre du secret et de la promesse, est donc nécessairement hors du temps. Comme le testament est gardé celé jusqu’à la mort, le théâtre testamentaire de Lorca, issu d’une intériorité préservée, ne fut pour ainsi dire pas diffusé de son vivant, parce qu’il suscitait d’assez vives critiques, mais peut-être aussi en vertu de ce principe énoncé par le vieillard : « Les choses sont plus vivantes au-dedans de nous qu’exposées au-dehors au vent et à la mort …»
Le théâtre « exposé au dehors », représente pour Lorca le théâtre de son époque, Théâtre de la convention, qui flatte l’ennui d’un public normatif. Dans LE PUBLIC, il le désigne d’une formulation paradoxale « théâtre en plein air » (à ne pas confondre avec le théâtre « sous la lune » prôné par le Moustique dans la TRAGI-COMÉDIE DE DON CRISTOBAL ET DE ROSITA ! 6. Dans ce théâtre « en plein air », le temps, qui ne cesse pourtant de blesser en s’écoulant, est soumis à l’invariable répétition, au double mouvement du ressassement et de l’oubli. Le « plein air » est ici symbole de surface, d’exhibition fallacieuse, d’anti-secret. C’est le théâtre pour un public-troupeau, un public de moutons.
Inversement, le théâtre testamentaire de Lorca, élaboré dans l’ombre et sur des ruines, se veut « théâtre sous le sable », en deçà de la mouvance trompeuse des apparences :