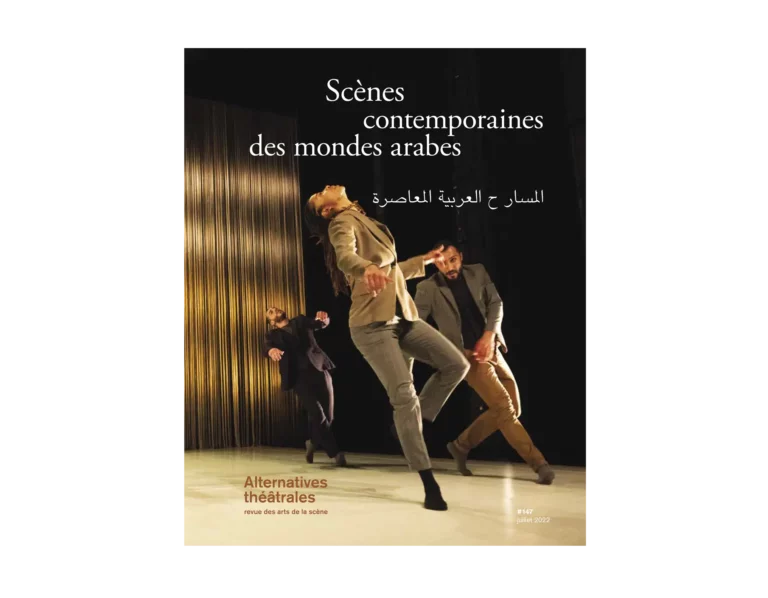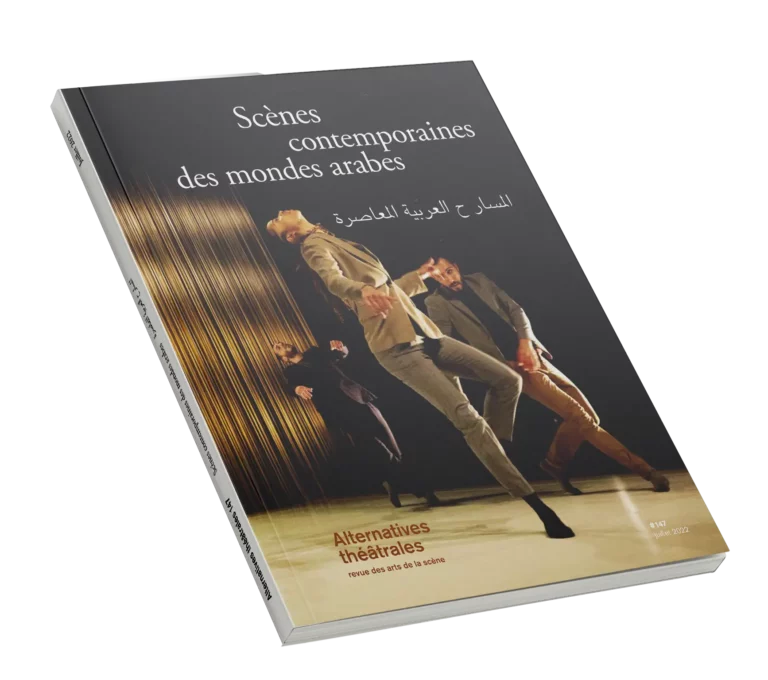Comment glisse-t-on des études d’architecture à la programmation artistique de festivals ?
Durant mes études d’architecture et d’urbanisme à Alger, j’ai toujours été guidée par un regard sur la société, les liens qui s’y créent. J’observais comment se négocient les « pouvoirs », comment les conflits perdurent et comment ils sont à même de séparer les groupes sociaux et d’en créer des nouveaux. L’architecture est une discipline artistique très ouverte. De nombreux cours et enseignements sont connectés avec la vie, la poésie : le mouvement des gens dans le bâti, les rapports entre espace public et espace privé. La poursuite de mes études pour un troisième cycle à l’Université de Louvain (K.U.L./Leuven) m’a confrontée à un milieu international très motivant, des gens venant d’horizons très différents, porteurs d’autres récits et d’autres conflits. J’ai dépassé ma petite histoire (d’une vie dans un État avec 30 ans de parti unique, son régime militaire et sa lente évolution vers la démocratie) et ouvert mon esprit à d’autres perspectives, d’autres associations envers les effets du colonialisme. Je pense que cela m’a fortement stimulée et consolidée dans une activité d’écriture. Et c’est à ce moment de grande curiosité envers les autres que j’ai rencontré la compagnie de théâtre Dito Dito (1) et ses ateliers. Dito Dito, c’est plus qu’une compagnie, c’est un lieu d’échange permanent, sans hiérarchie. J’écrivais des textes autour des questions politiques qui se posaient à Alger, Bruxelles et en Belgique. Il s’agissait de contribuer à transformer la ville, de la rendre plus vivable, plus juste, à partir d’une expérience artistique. Nous étions guidés davantage par une défense de l’hybridité que par celle du multiculturalisme.
Quelle différence fais-tu entre ces deux concepts ?
La multiculturalité considère chaque communauté avec sa culture propre et vise à faire accepter les différences, la diversité.
L’hybridité est une notion plus ouverte : chaque personne peut posséder et vivre plusieurs cultures et en partager les valeurs. La plupart des gens, surtout dans les villes, participent de plusieurs univers culturels.
Notre expérience à Dito Dito n’était pas uniquement de donner voix à ceux qui ne l’ont pas dans les arts de la scène, mais de se sentir autant concernés par la question de la frontière linguistique à Bruxelles, ensemble. En vivant à Bruxelles, on est partie prenante de ces enjeux et on peut y apporter un autre regard ! Cela nous permettait d’éviter un paternalisme ambiant, et un parrainage bien intentionné et toutefois nuisible…
Tu as la singularité de vivre à Bruxelles et de passer de longs mois en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour ton activité de curatrice et de programmatrice…
Même si le travail artistique nécessite de la solitude, j’aime être dans une « conversation » de travail et rester à l’écoute de ce qui se tisse.
Mon travail se développe toujours à partir d’une perspective double. J’ai un ancrage à Bruxelles, j’aime travailler à partir de cette ville que j’aime et en même temps rester en lien avec ma mémoire, mon histoire pour les questionner avec les autres. Il ne s’agit pas de nostalgie mais, au contraire, de déceler les dynamiques contemporaines émergeantes dans le monde arabe et qui sont importantes à inscrire dans la grande histoire des langages artistiques contemporains. En premier lieu, ce sont des rencontres humaines. Les artistes avec lesquels je travaille, je les appelle mes « alliés de sens ». Dans ces villes que je pratique, Marrakech, Le Caire… les moyens de création sont faibles, quasi inexistants pour les expériences artistiques nouvelles. Cette confiance réciproque qui s’installe nous permet d’arriver à développer des projets ici et là-bas. Venus de différents horizons, nous défendons une contemporanéité de la performance, une liberté et une culture accessible à tous. Des artistes comme Taoufiq Izeddiou, Meryem Jazouli, Ali Chahrour… Parfois je les connecte, parfois je suis membre de l’équipe de création à part entière, et parfois je reste en retrait et en soutien à distance, d’une manière de protéger leurs parcours et solitudes. C’est vraiment ma passion : être à l’écoute, créer du lien. C’est un travail de dramaturge de déceler ces liens et les traduire en projets. Souvent, ces chorégraphes sont aussi des directeurs de festival, car si on ne crée pas les scènes, il n’y a pratiquement pas de cadre pour la danse et donc pas d’occasions de rencontrer les publics !
Qu’est-ce qui te guide dans ce travail de conseil et de « dramaturge » ?
L’engagement d’une recherche de l’expression de la contemporanéité, en dehors d’une définition eurocentriste. Il s’agit de « contaminer » la grande histoire et cette définition eurocentriste par des langages contemporains qui viennent du monde arabe. La dynamique artistique contemporaine est bien là, dans cette hybridité. Mon action, ma « bataille » consiste à la rendre visible sur nos scènes, à Bruxelles, au Caire et à Marrakech. Ce sont les villes qui m’ont permis ces alliances et complicités artistiques.